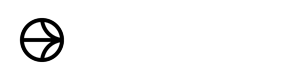Quel est le rapport entre la sortie du nucléaire et les frais de chauffage ?

Production brute d'électricité en Allemagne en 2006
Source : Fédération allemande de l'industrie de l'énergie et de l'eau (BDEW)
Mesdames et Messieurs
notre gouvernement fédéral vient de décider
- Les sept plus anciennes centrales nucléaires d'Allemagne, d'abord provisoirement arrêtées après la catastrophe nucléaire japonaise, ne seront plus jamais reconnectées au réseau.
- Les durées de vie restantes des dix autres centrales nucléaires sont limitées à une date fixe pour chacune d'entre elles.
- Fin 2022, l'énergie nucléaire sera définitivement abandonnée, mais la taxe sur le combustible sera maintenue.
- La recherche d'un site de stockage définitif s'intensifie et s'étend.
- Les réseaux électriques doivent être développés rapidement afin de transporter l'électricité éolienne du nord de l'Allemagne vers le sud. Pour ce faire, des câbles souterrains plus coûteux devraient être utilisés.
- Les parcs éoliens offshore, l'énergie hydraulique et la géothermie doivent être davantage soutenus, tandis que les aides aux installations solaires et aux éoliennes terrestres doivent être réduites. Parallèlement, les anciennes éoliennes devraient être remplacées par de nouvelles, plus puissantes.
- En plus des nouvelles centrales à charbon et à gaz déjà en construction, il est prévu d'ajouter environ 10 gigawatts de capacité de production d'énergie fossile. Il s'agira toutefois de centrales aussi efficaces et flexibles que possible. Les objectifs nationaux de réduction des émissions de CO2 doivent toutefois être maintenus.
- Dans un premier temps, les fonds destinés à la rénovation énergétique des bâtiments seront augmentés à 1,5 milliard d'euros par an pour les années 2012 à 2014. De plus, les mesures visant à réduire la consommation d'énergie seront plus facilement déductibles des impôts. Le gouvernement veut ainsi parvenir à ce que deux pour cent du parc immobilier soient rénovés chaque année afin d'économiser de l'énergie et de réduire les émissions de CO2.
Source : AFP, WELT ONLINE, WIKIPEDIA
Qu'est-ce que cela signifie pour nous ?
Nous renonçons dès à présent à sept des 17 ou 41% de nos centrales nucléaires, qui assuraient encore en 2009 23% de la production brute d'électricité selon la Fédération allemande de l'industrie de l'énergie et de l'eau (BDEW). Il nous manque donc dès à présent et de manière approximative 9% de notre capacité de production d'électricité, que nous pouvons apparemment encore couvrir sans problème à partir des réserves existantes. Comme il n'y a actuellement plus de capacité éolienne, hydraulique, photovoltaïque ou de traitement des déchets, ce déficit doit être comblé par des combustibles fossiles (2009 : 57% de la production d'électricité) ou par la biomasse (2009 : 4% de la production d'électricité). Il convient de noter que les capacités de réserve des centrales électriques ne peuvent être utilisées qu'en augmentant l'utilisation de combustibles ! Au vu de la répartition, on peut estimer que plus de 90% de la puissance nucléaire arrêtée est actuellement couverte par l'utilisation supplémentaire de combustibles fossiles. Si l'on souhaite à l'avenir augmenter la capacité des centrales fossiles de la manière la plus "efficace et flexible" possible, cela ne peut que signifier que la part du gaz naturel (13% de la production d'électricité en 2009) dans la production d'électricité doit avant tout augmenter, car les turbines à gaz sont extrêmement flexibles et, en combinaison avec des turbines à vapeur en aval, extrêmement efficaces. En outre, le gaz est le combustible fossile qui produit le moins d'émissions de CO2. En même temps, il s'agit de la source d'énergie la plus importante pour le chauffage des bâtiments en Allemagne, en particulier pour les ménages privés.
Conclusion : le chauffage avec des pompes à chaleur électriques ne sera pas le seul à augmenter ; préparez-vous à une hausse globale des coûts de chauffage, y compris pour le gaz et le fioul. Investissez cet été encore dans votre installation de chauffage afin de pouvoir profiter d'une réduction des coûts dès l'année prochaine.
Pourquoi a-t-on besoin des deux : chargement à deux zones et déchargement à deux zones ?
Ce qui s'est entre-temps répandu ...
est qu'une stratification aussi bonne que possible constitue l'alpha et l'oméga de l'utilisation efficace des ballons tampons. En effet, seul le réservoir le mieux stratifié possible peut encore absorber de la chaleur lorsqu'il est déjà relativement plein et en restituer lorsqu'il est déjà relativement vide. Le secret de cette utilité réside dans le fait qu'avec une bonne stratification, le réservoir est toujours chaud en haut et toujours froid en bas (image, tampon 2-4), tandis que le réservoir mélangé est chaud du haut en bas (image, tampon 1). La limite entre le chaud et le froid doit être la plus abrupte possible. Plus le réservoir est plein, plus il est bas (image, tampon 3), plus il est vide, plus cette limite est élevée (image, tampon 4).
Dans tous les cas, un réservoir bien stratifié ne contient si possible pas d'eau chaude du tout.
Une erreur à laquelle beaucoup sont encore sujets
Beaucoup de nos clients ont fait l'expérience d'améliorer sensiblement la stratification de leur réservoir tampon en utilisant les modules de décharge à deux zones rendeMIX 3×2 (pour un circuit de chauffage) ou rendeMIX 3×4 (pour deux circuits de chauffage), à tel point que l'efficacité globale des installations solaires a sensiblement augmenté et que les exploitants sont extrêmement satisfaits. D'autres ont constaté que le module de charge à deux zones rendeMIX 2×3 (avec élévation du retour pour une chaudière à bois ou une centrale de cogénération) leur apporte également des avantages sensibles. Mais ce que peu de gens ont compris, c'est que c'est justement la combinaison des deux procédés, c'est-à-dire l'utilisation simultanée de la charge et de la décharge de deux zones, qui permet au réservoir tampon d'atteindre son rendement maximal. Renoncer à l'un des deux simplement parce que l'on fait l'autre signifie donc tout simplement se contenter d'un résultat nettement moins bon.
[swfobj src="http://www.baunach.net/wp-content/uploads/be_und_entladung_p01_v05.swf" width="700″ height="525″ align="left" allowfullscreen="true"]
Pourquoi la combinaison des deux méthodes est-elle si efficace ?
Les deux méthodes s'attaquent en premier lieu au point faible de chaque ballon, l'eau chaude à température moyenne. Celle-ci est malheureusement toujours générée par des tourbillons inévitables dans l'accumulateur, qui ne peuvent jamais être totalement évités, même avec la vie intérieure la plus sophistiquée. L'utilisation systématique et prioritaire de cette eau chaude brassée permet toutefois de "nettoyer dynamiquement" le réservoir. En d'autres termes, la stratification est améliorée à mesure que la chaleur est transportée à travers le ballon. L'hypothèse selon laquelle le réservoir tampon est d'abord chargé par la source de chaleur et ensuite seulement déchargé par les consommateurs est en effet contraire à la réalité. En réalité, les deux processus se déroulent toujours plus ou moins simultanément.
Exemple 1
Lorsqu'une chaudière à bois de 20 kW alimente une installation de 20 kW via un tampon, la capacité thermique de l'accumulateur reste constante. Néanmoins, le chargement et le déchargement simultanés de l'accumulateur selon le procédé à deux zones entraînent le prélèvement de toute l'eau chaude mélangée et la reconstitution complète de la stratification de l'accumulateur.
Exemple 2
Si le prélèvement de puissance dépasse 20 kW, le réservoir tampon se vide lentement mais sûrement, car la puissance manquante est prélevée sur sa réserve de chaleur.
Exemple 3
Si le prélèvement de puissance descend en dessous de 20 kW, le réservoir tampon se remplit lentement mais sûrement, car l'excédent de puissance est ajouté à sa réserve de chaleur.
Conseil de pro : bien sentir, c'est à moitié gagné
Qu'est-ce que la qualité d'une boucle de régulation ?
Un régulateur compare en permanence une valeur de consigne prédéfinie avec une valeur réelle mesurée et détermine une réaction (grandeur de commande) à partir de la différence (écart) dans le but de rendre l'écart entre la valeur de consigne et la valeur réelle aussi faible que possible. Si, par exemple, une température de retour constante de 60°C est exigée pour une centrale de cogénération, il s'agit de la valeur de consigne, tandis que la valeur réelle est déterminée par une sonde de température. Comme réaction, on pourrait envisager un signal à trois points qui, par le biais d'un entraînement électrique, ouvre, arrête ou ferme une vanne de mélange, de sorte que la température de retour soit augmentée, maintenue ou abaissée.
Par qualité de la boucle de régulation, on entend avant tout la précision et la rapidité avec lesquelles le régulateur rapproche la valeur réelle de la valeur de consigne, par exemple après un changement brusque de la valeur de consigne au moment T. Dans le cas idéal, la valeur réelle ne dépasse qu'une seule fois légèrement l'objectif et se rapproche ensuite de la valeur de consigne à partir de ce côté. Si le régulateur est trop lent, il s'écoule trop de temps avant que l'objectif ne soit atteint. Si le régulateur est trop rapide, il oscille plusieurs fois au-delà de la cible. Comme, dans notre exemple, le servomoteur fait également partie de la boucle de régulation et influence donc sa qualité, son temps de fonctionnement doit être correctement réglé sur le régulateur, si cette option existe.
Qu'est-ce qu'un temps mort ?
Par temps mort du système de régulation, on entend le temps qui s'écoule avant que l'effet d'une modification du régulateur ne soit détecté par la sonde. Si, par exemple, la sonde de notre augmentation du retour susmentionnée se trouve à l'entrée du retour de la centrale de cogénération, alors que le mélangeur a été monté à 5 m de là, le temps mort est au moins aussi grand que le temps de parcours (t) nécessaire à l'eau pour parcourir la distance (s) à la vitesse (v) du mélangeur à la sonde.
t = s / v
v = Q / A = Q / ¼πDN²
Pour une unité de cogénération d'une puissance thermique de 12,5kW, qui fournit 80°C au départ et reçoit 60°C au retour, le Delta-T est de 20K et le débit (Q) est donc de 0,54m³/h. On obtient ainsi les vitesses d'écoulement (v) suivantes pour les diamètres nominaux suivants et les durées de fonctionnement (t) suivantes pour un tronçon de 5m par exemple :
| DN [mm] | v [m/s] | t [s] | |
| 15 | ½“ | 0,84 | 5,9 |
| 20 | ¾" | 0,47 | 10,6 |
| 25 | 1″ | 0,30 | 16,5 |
| 32 | 1¼" | 0,19 | 27,0 |
Il en ressort tout d'abord qu'un diamètre nominal fortement surdimensionné entraîne une nette augmentation des temps morts. Et cela constitue certainement un obstacle à une qualité de régulation élevée.
Pourquoi le montage correct des sondes est-il si important ?
En outre, il est clair que la distance entre la sonde et le mélangeur doit être la plus petite possible afin de ne pas augmenter inutilement le temps mort. Le lieu de montage de la sonde est donc le premier paramètre à prendre en compte.
Mais le transfert de chaleur de l'eau de chauffage à la sonde constitue également un obstacle qui a une incidence sur le temps : plus le transfert de chaleur est bon, plus la sonde réagit rapidement. Les sondes de contact, qui sont montées de l'extérieur sur la conduite dans laquelle circule l'eau de chauffage à mesurer, sont particulièrement répandues. Trois facteurs entrent essentiellement en ligne de compte :
Surface de contact
La surface de contact doit être la plus grande possible. Si, par exemple, une sonde est placée longitudinalement sur un tube ondulé, le transfert de chaleur ne disposera que de plusieurs petits points.
Dans le cas d'un tube lisse, le contact entre la sonde et le tube est encore constitué d'une ligne. Ce n'est qu'en utilisant une pâte thermique ou un autre pont thermique que la ligne devient la surface de contact nécessaire pour garantir un transfert de chaleur rapide.
Conductivité thermique des matériaux de transition
Les métaux sont les meilleurs conducteurs de chaleur, contrairement aux matières plastiques, aux oxydes (rouille) ou autres impuretés. C'est pourquoi le tube doit être en métal et soigneusement nettoyé avant le montage de la sonde.
Force de pression
La tension de la force de serrage doit être maintenue durablement de manière élastique, ce dont il faut tenir compte lors du choix du ruban de serrage. Dans cette mesure, un fil à ressort en spirale est certainement meilleur qu'un serre-câble et un serre-câble est certainement meilleur qu'un ruban adhésif.
Dans tous les cas, l'expertise et le soin du monteur sont nécessaires pour éviter à ce stade des erreurs inutiles qui, dans le pire des cas, pourraient dégrader la qualité de la boucle de régulation au point d'entraîner des variations de température permanentes dans le retour de la centrale de cogénération.